Le don des dieux ?
Hérodote, génial historien, et donc forcément géographe, l'a écrit il y a 2 500 ans une fois pour toutes : l'Égypte est un « don du Nil » (doron tou potamou). A l'heure où s'impose l'immense chantier de l'histoire environnementale, nous avons décidé d'aller y voir d'un peu plus près.
Ce que visait à vrai dire la formule du voyageur grec, plus agronome qu'il n'y paraît, ce n'était pas les pyramides, mais plus précisément l'alluvionnement du Delta. Il n'était pas absurde qu'un observateur, habitué aux étés secs et aux pluies rares du régime méditerranéen, soit impressionné par une terre miraculeusement fécondée chaque année, entre juillet et octobre, par les eaux généreuses de la crue. Seuls des dieux pouvaient être à l'origine d'une pareille aubaine : « Les bêtes en piétinant enfouissent la semence, l'homme n'a qu'à attendre le temps de la moisson. »
Les historiens nous délivrent aujourd'hui un tout autre récit : celui du travail acharné fourni, dans chaque village, par des paysans charriant dans des paniers la terre pour construire digues et bassins, et rivaliser d'efforts et d'ingéniosité pour transformer le don de l'eau en épis lourds. La crue est un miracle, soit. Encore faut-il savoir en tirer parti.
L'Égypte, d'ailleurs, c'est vite dit. Le plus long fleuve du monde (environ 6 800 km, dont à peu près seulement 1 000 km sont égyptiens), revendiqué aujourd'hui par dix États riverains, a une histoire transnationale. Il n'allait pas de soi qu'il fût si fortement identifié à l'Égypte. Le Moyen Age l'imaginait surgir du paradis, et la recherche des sources poussa pendant trois cents ans les voyageurs les plus hardis, des Jésuites aux officiers britanniques de l'Armée des Indes, au coeur des forêts d'Afrique.
Il y avait de quoi s'y perdre : deux bassins d'alimentation, l'un se déversant des montagnes du Rwanda et du Burundi vers le lac Victoria (le Nil Blanc), l'autre descendant de la « montagne de la Lune » et du lac Tana (le Nil Bleu), en Éthiopie, qui fournit jusqu'à 80 % de ses eaux. La confluence se fait à Khartoum, au Soudan, autre puissance nilotique, héritier lui aussi de brillantes civilisations, dont l'archéologie nubienne en plein essor nous fait découvrir aujourd'hui l'importance : à l'aube du IIe millénaire, les rois de Koush étaient assez puissants pour faire reculer la frontière égyptienne jusqu'à la 1re cataracte, à Assouan.
Reste qu'au temps de Ramsès II, c'est bien l'Égypte qui prend possession du Nil. Sa civilisation en est indissociable : une mythologie née du fleuve où fut jeté le cercueil d'Osiris, des dieux en barque, des papyrus qui conservent sur des milliers de pages une des premières écritures du monde. Sans oublier les crocodiles, les oiseaux ou gibiers du Delta, ni les poissons qui inspirèrent à Geoffroy Saint-Hilaire ses théories sur l'unité du vivant.
Les conquérants ne s'y sont pas trompés. Des Romains aux Arabes, qui plantent leur capitale, Fustat puis Le Caire, au creux d'un méandre, à la jonction stratégique du Delta et de la Vallée, tous les pouvoirs ont eu leur nilomètre, témoignant du caractère vital de la crue.
Avec Méhémet-Ali vint le temps des ingénieurs, et de l'immense révolution de l'irrigation pérenne. Dans les années 1960, le barrage d'Assouan, nouveau chantier pharaonique, assure au pays du grain et de l'électricité à revendre, et à Nasser sa stature de nouveau maître du Nil. Avec la bénédiction de l'Unesco, le transfert-sauvetage des temples d'Abou Simbel est un spectacle mondial.
Un demi-siècle plus tard, le bilan écologique et politique de cette affaire est mitigé. Avec la construction du grand barrage dit « de la Renaissance éthiopienne » la question de l'eau est devenue un enjeu régional majeur. Mais on reste saisi d'admiration devant ce que, depuis 5 000 ans, des hommes et des femmes ont su faire de ce ruban de vie au milieu du désert. Faire l'histoire du fleuve, c'est aussi une autre façon de faire l'histoire de l'Égypte.

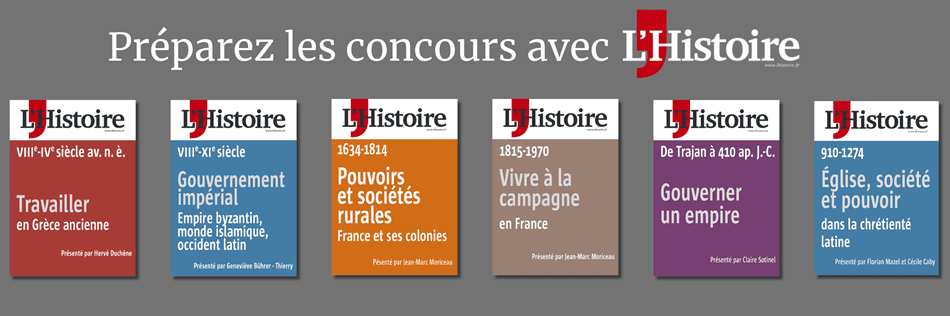




.png)
.png)
